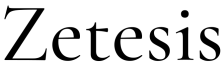Tels furent les points de départ de la philosophie moderne qui prit autorité dans le monde chrétien, alors que la raison se déclara ouvertement indépendante et prétendit fonder la science en elle-même et par ses propres forces.
Depuis ce temps, la philosophie est redevenue tout-à-fait païenne, partant du doute, ne croyant ou s’imaginant ne croire à rien, pas même à la première de toutes les vérités à l’existence de Dieu, pour se donner le plaisir de prouver que Dieu existe ou qu’il n’existe pas, marchant à tâtons comme dit l’Apôtre, cherchant Dieu, l’immuable, l’absolu, dans les phénomènes de la nature qui ne sont jamais deux instants les mêmes ou transportant la nature en Dieu. Elle n’a plus de rapport avec cette sagesse éternelle, aimée de Pythagore, reconnue par Platon, proclamée par Salomon, et que Paul annonçait aux parfaits : non-seulement elle ne la connaît plus, mais elle repousse tous les moyens par lesquels cette source de toute science se communique à l'homme. Aussi, que cette philosophie ait continué à suivre le chemin du rationalisme avec Descartes, qu’elle ait essayé toutes les voies de l’empirisme sur les traces de Bacon et de Locke, ou qu’elle soit rentrée dans la sphère du platonisme avec le génie spéculatif de l’Allemagne, ou enfin qu’en désespoir de cause elle soit redevenue éclectique ou néo-platonique de nos jours, toujours est-il qu’elle n’arrive à autre chose qu’au renouvellement des systèmes et des erreurs déjà épuisés par les anciens. Elle se vante de rechercher la vérité dont, au fond, elle s’inquiète peu, à l’existence de laquelle elle croit à peine, puisqu’elle prétend n’y croire qu’à la condition de l’évidence ou de la démonstration. Ne pouvant s’élever jusqu’à la source de toute vérité et ne voulant point la reconnaître dans son expression, elle la cherche dans les opinions incertaines et dans les pensées flottantes des hommes ; elle travaille sans cesse à détruire pour reconstruire, à faire table rase pour bâtir de nouveau ; elle doute de ce qu’elle avait affirmé, elle abat ce qu’elle avait élevé, elle prétend expliquer l’homme et le monde, refaire la science et la société, et quand elle se met à l’œuvre pour édifier, elle n’a ni base, ni plan, ni but. Ce qu’on appelle philosophie de nos jours n’est vraiment plus qu’un instrument de destruction, servant à ébranler, à saper, à renverser. C’est par là que ces systèmes et ces doctrines sont foncièrement en opposition avec l’esprit du Christianisme, qui est essentiellement conservateur. C’est le panthéisme en opposition avec le théisme; c’est l’esprit du monde en contradiction avec l’esprit de l’Évangile ; c’est la continuation de la lutte entre l’idolâtrie et les adorateurs du vrai Dieu.
L’Église chrétienne persiste cependant au milieu de ce débordement d’opinions, de sophismes et de passions. Immuable dans sa foi et sa doctrine, ferme dans sa confiance et dans son espérance, active dans sa.charité, elle subsiste dans son gouvernement et sa hiérarchie ; elle est au fond la même qu’au jour de sa naissance. Mais, comme vous l’avez remarqué, il manque quelque chose à la plupart de ses ministres, quelque chose que l’état de la société, à laquelle ils doivent annoncer la parole du salut, réclame im périeusement: c’est la science de l’homme, de sa nature, de ses rapports et de sa loi, c’est la science historique de l’humanité, c’est la philosophie chrétienne en un mot. On peut être bon Chrétien par la foi seule, sans aucune science explicite ; car qui a le plus a le moins, et j’adhère de tout mon cœur à la parole du Maître : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! · Mais il n'en est pas moins vrai qu’il faut une science profonde pour enseigner à des intelligences éclairées une doctrine profonde ; que c’est par la connaissance des choses sensibles et de leurs lois que l’homme est préparé à la foi et à la compréhension des choses intelligibles, et qu’une société engouée comme la nôtre de la philosophie païenne, envahie par des doctrines superficielles ou erronées, enchantée par les connaissances naturelles, ne peut être ramenée au goût du vrai, du beau et du bien que par un enseignement vaste et profondément scientifique. De pauvres pêcheurs furent envoyés pour prêcher l’Évangile aux pauvres, après avoir été instruits eux-mêmes par Celui qui est la voie, la vérité et la vie : mais il a fallu un Apôtre savant pour évangéliser la Grèce et l’Italie savantes ; il a fallu la vertu et la science de la sagesse divine pour confondre les vains discours de la sagesse humaine. C’est dans l'insuffisance et l’imperfection des études qu’on fait faire à la jeunesse, au moment où elle se prépare à entrer dans le monde ou dans l’Église ; c’est dans le fond et dans la forme de l’enseignement philosophique, qui n’est plus en harmonie avec l’état du siècle et les besoins des esprits, et que les uns s’obstinent à conserver, tandis que les autres l’abandonnent à l’arbitraire ; oui, c’est ici que se trouve la cause principale de la maladie qui ronge la société ; c’est ici que se montre la plaie profonde que le rationalisme a faite à l’Église et qu’il agrandit tous les jours. Pour vous convaincre de cette triste vérité, il nous suffira d’examiner rapidement ce qui est enseigné sous le nom de philosophie dans nos écoles. (Philosophie du Christianisme, 1835, Tome 2, pp. 16-19)